|
Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer. Cartographie des inégalités | 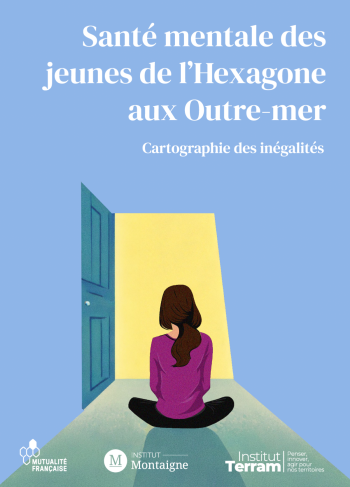 |
| | 
Cinq ans après la crise du COVID, alors que les signaux de détresse psychique se multiplient, en particulier chez les jeunes, la santé mentale s’impose enfin en 2025 comme une grande cause nationale. Pour contribuer à ce mouvement et éclairer les réalités de cette génération confrontée à un mal-être profond, la Mutualité Française, l’Institut Montaigne et l’Institut Terram se sont associés pour dévoiler aujourd'hui une enquête inédite intitulée “Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer. Cartographie des inégalités”, menée au printemps 2025 auprès de 5 633 jeunes âgés de 15 à 29 ans représentatifs de la population française, y compris dans les Outre-Mer.
Cette enquête se distingue par son approche à la fois transversale et ancrée dans les territoires qui met en évidence les fragilités durables dans la santé mentale des jeunes, liées aux conditions de vie, d’étude, de travail, à la précarité, au rapport au numérique, à l’environnement familial ou encore à l’ancrage territorial. Elle explore également les freins à l’accès aux soins, les lacunes en matière de prévention, mais aussi les ressources mobilisées, les formes de soutien disponibles et les attentes exprimées par les jeunes.
|
|
| 
"Cette étude, inédite par son ampleur et sa profondeur, révèle des constats alarmants sur la santé mentale des jeunes dans tous les territoires. Face à cette réalité, nous ne pouvons plus rester spectateurs. En cette année où la santé mentale est la grande cause nationale, il est encore temps de franchir un cap et bâtir une politique ambitieuse, cohérente et durable, en s’appuyant sur les recommandations formulées par les jeunes. C’est une urgence sociale. Et c’est une responsabilité collective." Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité Française  "La santé mentale et la jeunesse sont deux piliers des travaux de l’Institut Montaigne depuis plus de quinze ans. Dans cette continuité, l’enquête étudie en profondeur les causes de la santé mentale dégradée des jeunes en hexagone, et encore plus, en Outre-Mer. Instabilité dans l’enfance, précarité économique, stress, harcèlement, lieu de vie sont autant de déterminants qu’il faut considérer pleinement pour pouvoir y répondre." Margaux Tellier-Poulain, responsable de projets Santé et Protection Sociale à l’Institut Montaigne  "La santé mentale des nouvelles générations traverse l’ensemble du territoire, mais elle ne s’y manifeste pas avec la même intensité. Les chiffres, s’ils sont alarmants, doivent être replacés dans les environnements concrets qui façonnent les expériences de la souffrance psychologique ou psychique : des zones rurales à la la densité des métropoles, des foyers sécurisants aux situations de rupture familiale, des espaces de solitude aux injonctions de l’hyperconnexion, les conditions d’apparition et d’expression de la détresse varient considérablement." Victor Delage, directeur général de l’Institut Terram |
| 1 jeune sur 4 souffre de dépression (25 %) : un mal-être psychique généralisé |
| - Fatigue, repli, perte d’intérêt : les problèmes psychologiques et les troubles psychiques s’accumulent chez les jeunes qui font face à une véritable crise silencieuse. Certaines situations de mal-être présentent une très forte prévalence parmi les jeunes mais le chiffre le plus inquiétant demeure sans doute celui-ci : près d’1 jeune sur 3 (31%) affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires ou envisagé de se faire du mal.
- Le stress scolaire et professionnel est massif : 87 % des jeunes stressés par leurs études, 75 % par leur travail. Ce stress pèse lourdement sur leur santé mentale : alors que ce stress pèse lourdement sur la santé mentale des étudiants et des actifs, l’instabilité de l’emploi accentue le mal-être notamment chez les indépendants, les chômeurs et les salariés à temps partiel.
- Le harcèlement, facteur de mal-être aggravant : alors que 26% des jeunes interrogés ont déjà été victimes de cyberharcèlement et 31% victimes de harcèlement scolaire, leur santé mentale en pâtit tout particulièrement, générant de nombreuses situations de dépression.
|
| Outre-mer, genre, âge et métropole : des détresses inégales |
| - Les jeunes ultramarins sont les plus sévèrement touchés : 39 % souffrent de dépression (contre 25 % en moyenne pour l’ensemble de la France). Plus d’un jeune sur deux en Guyane (52 %) est concerné, 44 % en Martinique, 43 % à Mayotte, des niveaux sans équivalent en Hexagone, où les proportions oscillent entre 19 % (Bourgogne-Franche-Comté) et 28 % (PACA).
- Les jeunes femmes apparaissent plus affectées : 27 % souffrent de dépression, contre 22 % des jeunes hommes. L’écart est particulièrement significatif avant 22 ans (29% des femmes de moins de 22 ans contre 19% des hommes du même âge) et tend à diminuer avec l’âge. Cette vulnérabilité de genre s’observe aussi dans les autres indicateurs : troubles du sommeil , fatigue persistante, stress lié aux études.
- Les jeunes urbains sont les plus touchés : 27 % sont en dépression, contre 20 % en zone rurale. Le sentiment de tristesse ou de désespoir touche 64 % des jeunes en métropole, contre 54 % en milieu rural.
|
| Un accompagnement encore trop éloigné des besoins exprimés par les jeunes |
| - Les chiffres sont sans appel, mais une question demeure : face à cette réalité, les jeunes ont-ils réellement accès à des dispositifs d’accompagnement ? L’enquête met en lumière les limites des réponses publiques en matière de santé mentale : dispositifs fragmentés, peu lisibles, difficilement accessibles. À cela s’ajoutent de nombreux freins au recours à l’aide professionnelle : peur de la stigmatisation, méconnaissance des ressources disponibles, peine à identifier les interlocuteurs, obstacles matériels ou logistiques. Ainsi, 38 % des jeunes ont déjà évoqué leur santé mentale avec un professionnel, et 21 % l’ont fait à plusieurs reprises. Ce chiffre chute à 19 % chez les 15-17 ans. Plus d’un tiers des jeunes qui ressentent le besoin de consulter ne franchissent pas le pas. Dans les DROM, où les indicateurs de souffrance psychiques sont plus prononcés, le recours est pourtant encore plus limité : 30 % seulement des jeunes ont consulté un professionnel, 27 % à Mayotte.
- Un autre enjeu est de mieux sensibiliser, et autrement : 76 % des jeunes déclarent avoir été sensibilisés à la santé mentale. Si les proches et les initiatives de l'établissement scolaire ou universitaire jouent encore un rôle important, les réseaux sociaux sont aujourd'hui leur canal d'information privilégié. Or, l’accès à une information fiable, encadrée, et de qualité reste crucial pour prévenir les troubles et accompagner les jeunes.
- Loin d’être de simples consommateurs du système, les jeunes aspirent à être des acteurs sur lesquels s’appuyer pour proposer des solutions. C’est dans cette optique que l’étude a intégré une question prospective sur les mesures jugées les plus efficaces pour améliorer leur santé mentale. Les jeunes formulent des demandes concrètes et cohérentes : faciliter l’accès aux soins psychologiques (36 %) et à la prévention (36 %), les rendre plus accessibles (34 %), promouvoir des leviers de bien-être - sport, culture, activités de sociabilité (16 %), renforcer les compétences psychosociales (13%).
|
| | À propos de la Mutualité Française Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, la Mutualité Française, présidée par Eric Chenut, représente près de 500 mutuelles. Nées de la volonté de femmes et d’hommes de se protéger solidairement des aléas de la vie, les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif. Elles sont présidées par des militants mutualistes élus. Elles agissent pour la protection sociale de 32 millions de Français et promeuvent le droit de tous à la pleine santé en intervenant en complémentarité et en partenariat avec la Sécurité Sociale et en contribuant au service public de santé. Les mutuelles, groupes et unions proposent des solutions dans trois domaines d’activités : complémentaire santé, prévoyance-dépendance et épargne-retraite. Avec plus de 2900 services de soins et d’accompagnement mutualistes, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention en santé par les actions déployées sur l’ensemble du territoire. Au quotidien, les membres de la Mutualité Française déclinent autour de trois territoires d’engagement - proximité, participation et innovation - sa raison d’être : “Se protéger mutuellement aujourd'hui pour, ensemble, construire les solidarités de demain”. À propos de l’Institut Montaigne Créé en 2000, l’Institut Montaigne est un espace de réflexion, de propositions concrètes, et d’expérimentations au service de l’intérêt général. Think tank de référence en France et en Europe, ses travaux sont le fruit d’une méthode d’analyse rigoureuse, critique et ouverte qui prennent en compte les grands déterminants sociétaux, technologiques, environnementaux et géopolitiques afin de proposer des études et des débats sur les politiques publiques. Association à but non lucratif, l’Institut Montaigne organise ses travaux autour de quatre piliers thématiques : la cohésion sociale, les dynamiques économiques, l’action de l’État et les coopérations internationales. Menés dans la collégialité et l’indépendance, l’Institut Montaigne réunit des entreprises, des chercheurs, des fonctionnaires, des associations, des syndicats, des personnes issues de la société civile et d’horizons divers. Nos travaux s’adressent aux acteurs publics et privés, politiques et économiques, ainsi qu’aux citoyens engagés. Depuis sa création, ses financements sont exclusivement privés, aucune contribution n'excédant 1,2 % d'un budget annuel de 7,2 millions d'euros. À propos de Terram L’Institut Terram est un groupe de réflexion collégial et multidisciplinaire dédié à l’étude des territoires. Il fait de la dynamique territoriale un pilier central de l’innovation économique, industrielle et numérique, de la préservation de l’environnement et de la décarbonation, de l’accès aux services publics, de la valorisation du patrimoine culturel et de la cohésion sociale. L’Institut Terram publie des rapports à caractère scientifique, réalise des enquêtes inédites à l’échelle des territoires, produit des podcasts et organise des débats, des séminaires et des ateliers dans toute la France. Par ses travaux, il contribue à revitaliser le débat public, facilite les échanges d’idées et est à l’initiative de recommandations concrètes au service de l’intérêt général. L’institut est un espace de discussion unique pour tous ceux qui s’intéressent au devenir des territoires. Il réunit des chercheurs, des experts, des représentants d’entreprises, des fonctionnaires et des acteurs de la société civile. L’Institut Terram est une association 1901 à but non lucratif. Il agit en toute indépendance et n’est affilié à aucun groupement de nature politique. Le soutien des entreprises et des particuliers permet le déploiement de ses activités. |
| | |
|